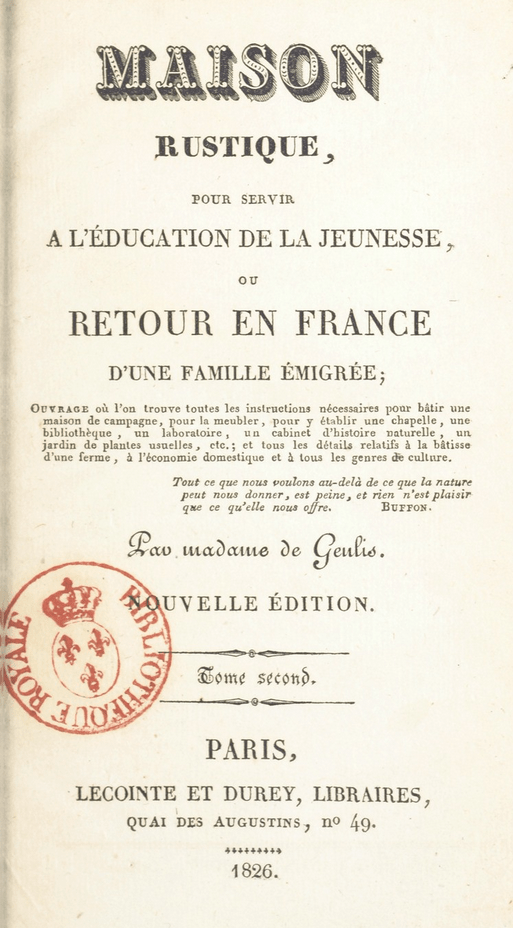Enfant, Emeline rêvait d’être architecte. Quand nous avions dix ans, elle dessinait des plans dans des cahiers de brouillon. Puis, à l’époque où nous nous intéressions plus aux garçons qu’aux bonbons, elle récupérait nos Légo abandonnés et les vieux Kapla pour édifier des cités chimériques dans le garage de son père. Je l’avais perdue de vue après le lycée mais, quand je découvrais des immeubles démentiels au cœur des pages épurées et glacées des magazines déco, j’étais surprise de ne pas lire son nom.
Je la retrouvais finalement en bas de chez moi, un jour où j’étais allée me plaindre du vacarme matinal sur le chantier mitoyen de mon immeuble. Aguerri aux querelles de voisinage, le premier ouvrier que je rencontrais me conduisit calmement auprès du chef de chantier. Il était penché sur une série de plans. Un détail m’interpela. Sous le casque jaune obligatoire dépassait une chevelure aux boucles en bataille grossièrement domptée par un élastique fatigué. Ses traits s’étaient épaissis mais je reconnus mon ancienne amie dès qu’elle tourna son visage vers moi.
Emeline avait laissé ses rêves d’enfant dans le garage de son père. Les études d’architecte sont longues et coûtent cher. Elle était tombée dans le béton, m’expliqua-t-elle dans un grand éclat de rire au café du coin. Elle avait toujours les mêmes yeux malicieux et cette voix haut perchée qui cadrait mal avec sa poitrine opulente et des bras de déménageuse.
Emeline revint dans ma vie comme si nous ne nous étions jamais quittées. Elle était concrète, arrimée à la ville par son béton armé, solide et sûre. Elle grignotait les hommes comme on goûte les fruits de saison, avec gourmandise, profitant de l’instant présent. A la fin de la saison, elle passait à autre chose. La vie est simple quand tu fais ce que tu aimes, me disait-elle. Moi, je n’avais personne dans mon coeur, ni même dans mon lit. J’enchaînais les heures supplémentaires. Je rentrais tard, je sortais peu. Emeline écoutait mes états d’âme avec complaisance puis me tapait dans le dos en m’invitant à boire une bière.
Sa force me fascinait. Son énergie était contagieuse. Je comprenais que les hommes aient tellement envie d’être à ses côtés. Plus aucun d’entre eux ne s’offusquait d’ailleurs de travailler sous les ordres d’une femme. Ils respectaient sa volonté farouche et cet amour du BTP qu’elle clamait dans le grondement des pelleteuses et des marteaux-piqueurs.
Alors que le nouvel immeuble de ma rue n’était pas encore terminé, Emeline s’éclipsa quelques jours. T’en fais pas poulette, m’avait-elle rassurée, j’ai un truc à faire pour un pote. Je reviens vite. Je la regardais partir dans une camionnette chargée de planches, de poutrelles et de parpaings. Vus depuis mon balcon, ils me rappelaient les Légo et les Kapla de notre jeunesse.
En définitive, Emeline s’absenta plus d’un mois. Elle s’était arrangée pour le chantier. Elle m’avait envoyé un texto pour me prévenir qu’elle reviendrait finalement plus tard. Avec une belle surprise, avait-elle ajouté avant de terminer par un émoji clin d’œil. Puis elle avait éteint son téléphone. Elle me manqua. Les bruits du chantier recommencèrent à me taper sur les nerfs. Un jour, je vis passer sa camionnette dans une rue voisine. Je me mis à courir pour la rattraper. Mais le feu à l’intersection était vert, je n’avais aucune chance. Je restais plantée là, comme une merde de chien oubliée sur un trottoir.
Un dimanche matin, je reçu enfin un texto d’Emeline. Elle m’envoyait la photo d’une grosse cabane en bois. Et voilà ! disait la légende. Comme je ne comprenais pas, elle résolut de venir me chercher. Ce n’est pas le genre de chose qu’on peut partager au téléphone, m’avait-elle expliqué. Sa camionnette dégageait une odeur animale un peu âcre derrière des notes de bois et d’herbe. Malgré ses ongles noirs et ses chaussures crasseuses, Emeline était resplendissante. Elle voulait me présenter quelqu’un.
Emeline tournait à gauche, prenait à droite et empruntait des ronds-points avec une dextérité tranquille au milieu des pavillons et des barres d’immeuble. Parfois, un groupe de jeunes en joggings sombres et baskets blanches dodelinait à un abris-bus, le volume de leur enceinte poussé au maximum. Ici, un homme encapuchonné promenait un pit-bull muselé. Là, une femme transportait de lourds sacs plastiques, invectivant son petit garçon qui traînait à l’arrière, sous les regards impassibles d’un groupe d’hommes fumant à la terrasse d’un bar-tabac.
Après une rangée de hautes tours aux noms de femmes, Emeline s’engagea dans l’enceinte d’une petite usine surmontée de deux grandes cheminées. Devant les façades blanches du bâtiment aveugle se dressait la cabane de la photo. Une demi-douzaine de moutons paissait tranquillement dans l’herbe.
Tiiiiiiiiiiiii bidi bidi bidi bidi bidiiiiii ! lança Emeline quand elle fut descendue de la camionnette.
Une petite brebis désinvolte leva immédiatement la tête et se dirigea vers Emeline d’un pas décidé. Les autres la suivirent tranquillement. Emeline s’était agenouillée, les bras ouverts. Les brebis vinrent se blottir contre elle, lancèrent quelques coups de tête affectueux et se remirent à brouter paisiblement tandis qu’Emeline continuait de caresser la première brebis.
Elle s’appelait Castafiore. Elle avait beau être la plus petite, c’était la cheffe.
Emeline était venu construire un abri pour le troupeau avec trois amis. Le maire avait accepté d’accueillir les bêtes et leur berger, Paul, sur le terrain de la chaufferie au gaz de la cité des Eglantiers. Paul avait profité de la présence des constructeurs pour s’octroyer quelques jours de repos. Il avait laissé les brebis sous leur surveillance. L’herbe du terrain suffirait à les nourrir le temps de son absence.
Castafiore s’était rapidement approchée des travaux de la bergerie. Elle tournait autour d’Emeline, la regardait avec une tendresse touchante puis se mit à bêler régulièrement pour l’interpeler. Emeline comprit que Castafiore demandait à sortir de l’enceinte de la chaufferie. Elle entama une véritable conversation avec elle. Elle lui expliqua qu’elle n’avait pas le droit de la faire sortir. Ça pouvait être dangereux. Dehors, il y avait les voitures, les chiens et certainement encore de nombreux dangers. Emeline craignait aussi de perdre le troupeau. Tu vois, Castafiore, si tu te fais la belle avec tes copines, moi je serais bien emmerdée, expliquait Emeline.
Après le premier week-end, les amis d’Emeline durent retourner à leurs emplois respectifs. Restée seule, Emeline continua ses conversations avec la brebis. Les yeux de Castafiore l’apaisaient. Aies confiance en moi, semblaient-ils dire. Le soleil brillait, la journée s’annonçait belle, Emeline n’avait plus grand-chose à faire pour terminer la cabane, elle décida d’emmener Castafiore et ses copines faire un tour.
A sa plus grande surprise, les brebis la suivirent sagement. Elle se sentit en harmonie avec elles. Quelques habitants reconnurent le troupeau mais la plupart étaient surpris de voir des moutons au cœur de leur cité. Les enfants approchèrent, joueurs et blagueurs, heureux de cette attraction nouvelle. Ils indiquèrent à Émeline un endroit paisible derrière la médiathèque. Emeline ne resta pas longtemps. Elle ne savait quoi répondre à ceux qui voulaient tout savoir sur les moutons. Et elle avait bien trop peur de perdre une bête.
Paul revint le lendemain. Emeline lui avoua qu’elle avait sorti les brebis, préférant affronter une colère justifiée. Paul l’écouta et se mit à sourire. Elles t’ont bien eu, tu sais, confia-t-il. Maintenant, tu ne pourras plus t’en détacher. Il avait raison. Bien que la cabane fût terminée, Emeline revint tous les jours à la bergerie. Elle apprit à guider les brebis, à les canaliser le long des trottoirs et à les faire traverser en sécurité. Paul lui indiqua les meilleurs pâturages et lui apprit le nom des plantes qui étaient bonnes pour les moutons. Emeline lui fit découvrir le carré de prairie de la médiathèque.
Désormais, Emeline était persuadée qu’elle devait abandonner le béton pour les moutons. Encore quelques mois de formation avec Paul et elle envisageait d’avoir son propre troupeau. Tu vois, cette plante dans le talus là-bas ? C’est de l’armoise, un vermifuge naturel pour les moutons, m’expliqua-t-elle. La ville était construite sur d’anciennes terres agricoles. La végétation y était excellente pour les brebis.
Emeline avait rencontré quelques personnes intéressées par un projet de coopérative urbaine. Ils commenceraient avec quelques bêtes puis verraient bien comment ça prendrait. Est-ce que je voulais en être ? Assise dans la verdure à côté d’Emeline, je me sentais sereine. Le thermos de café était posé par terre. J’avais retiré mes chaussures pour sentir l’herbe sous mes pieds. Je ne voyais même plus les tours qui encerclaient le terrain. Je m’imaginais bergère.
Puis je repensais à mon appartement confortable, à mon travail indispensable et à la réalité qui vous rattrape. J’eus peur. J’invoquais des raisons superficielles qui ne trompèrent pas Emeline. Elle objecta que je pouvais ne venir que les week-ends, que ce que l’on donne est généralement bien inférieur à ce que l’on reçoit. Je louvoyais. Emeline ne chercha plus à me convaincre. Elle m’invita simplement à venir de temps en temps pour voir les brebis puis elle me resservit du café dans un sourire sincère.
Je vins une fois. Puis je pris seulement des nouvelles. J’eus une promotion et j’oubliais d’appeler Emeline pendant plusieurs semaines. J’envoyais un texto. Je reçus la photo d’une nouvelle bergerie. Emeline avait maintenant la sienne, installée dans l’enceinte d’une gendarmerie pour qu’on ne lui vole pas ses moutons. Les gens ont faim, tu sais, expliqua-t-elle sobrement. Elle était heureuse. Et toi ? me demanda-t-elle. Je m’empressais de lui montrer que tout allait bien pour moi aussi. Je prenais du galon dans ma boîte. J’avais trouvé un appartement beaucoup mieux situé avec un parquet en chêne et d’adorables moulures. Il faudra que tu viennes voir, lui dis-je. Et puis le temps s’étira de plus en plus sans que nous ne nous donnions de nouvelles.
Quelques années plus tard, j’étais assise à la terrasse d’un petit café coloré sur les bords du canal en bas de mon quartier. Le client précédent avait oublié son journal. Je le feuilletais. A la dernière page, la photo d’Emeline s’étalait en grand sous le titre « La fabrique à sourires ».
On y parlait des cités et de ces jeunes urbains qui choisissent d’y faire revivre la nature. Le journaliste racontait les sourires des gens quand apparaissait le troupeau d’Emeline à l’angle d’une rue. Emeline citait Amadou, Nasser ou encore Vasilius. Venus d’ailleurs, du sud ou de l’est, des plaines ou des montagnes, ils avaient grandi avec des moutons. Ils avaient aidé Emeline à mieux comprendre ses bêtes. Personne ne klaxonnait quand il fallait attendre derrière son volant que les brebis aient traversé un rond-point. Quand les bêtes paissaient, on s’arrêtait bavarder. Les voisins se découvraient. Les rires fusaient au détour des conversations. Les moutons rendaient les gens heureux. Au milieu de son troupeau, entourée de visages de toutes les couleurs qui souriaient largement, Emeline resplendissait. Derrière elle, des tours de béton rappelaient ses rêves d’enfant. Elle avait réussi, elle était devenue une architecte de la vie.
Mon téléphone vibra. Visio dans dix minutes avec le CoDir. Je laissais le journal sur la table, la chaleur du soleil dans les bourgeons des arbres et les murmures du canal derrière moi. Je rejoignis mon appartement, ses jolies moulures et son wifi.
Nouvelle écrite en mars 2022