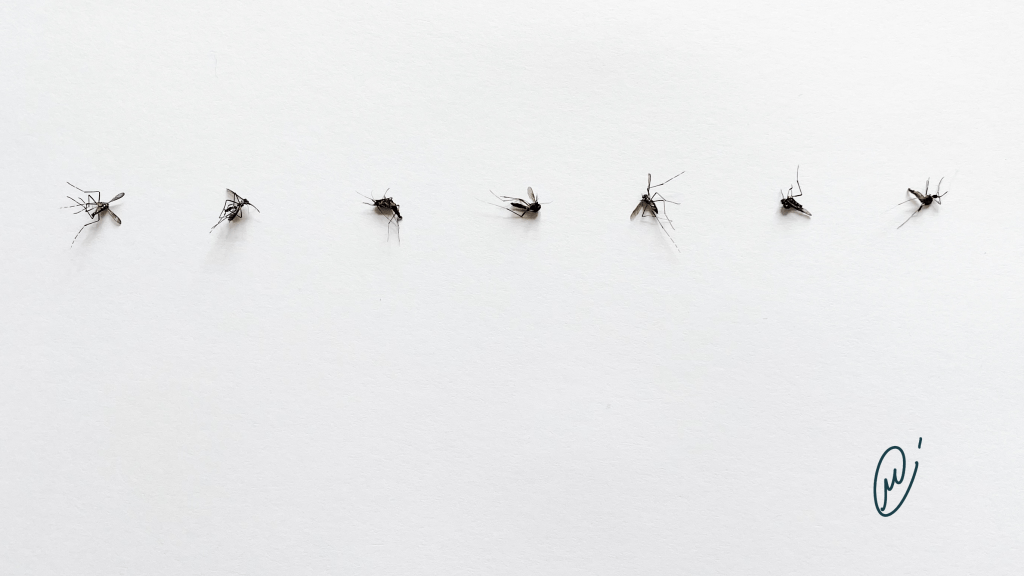J’ai profité du calme de la fin août pour m’inscrire sur le site de Babelio. Délectation de musarder de critique en critique et de découvrir des listes d’ouvrages, à la recherche d’idées de lecture.
Je me suis inscrite pour recevoir le dernier ouvrage d’un auteur canadien autochtone, Tiohtiá:ke de Michel Jean. Le titre est le nom Mowak de Montréal. On y suit un jeune Innu, Elie, qui débarque à Montréal après dix ans de prison. Il a assassiné son père. La peine de sa communauté est sans appel, il en est désormais banni.

Il découvre la ville, le bruit incessant, l’insécurité de la rue, l’errance des jours.
Mais il rencontre une communauté hétéroclite d’autochtones qui vivent en marge de la société blanche dominante. Il y trouve une certaine solidarité. Petit à petit, il se construit une sorte de famille de cœur et se bâtit une nouvelle vie.
Il y est question de transmission, ou plutôt de rupture de transmission avec l’envoi des enfants autochtones dans des pensionnats dont le but était avant tout de les couper de leur culture traditionnelle. L’alcool, la drogue et la violence ravagent les hommes et les femmes désœuvré.es des « territoires ».
A travers l’histoire d’Élie, Michel Jean aborde un monde inconnu pour la plupart des Québécois et encore plus pour une Française comme moi. Lors de la rencontre organisée par Babelio à Paris, une lectrice expliquait avoir vécu vingt-cinq ans à Montréal sans jamais avoir remarqué ces Autochtones dont Michel Jean raconte la vie dans les parcs et les rues de la ville. L’auteur a levé les bras dans un geste d’impuissance. Tout était dit.
Intéressant de l’écouter raconter sa vision de la société canadienne. Lui-même est d’origine innu. Déplacement du point de vue. Prise de conscience.
Une plongée dans un monde inconnu, dur et violent où le retour en arrière n’est pas possible. Lors de la rencontre, Michel Jean explique que les communautés autochtones du Canada ont vécu la fin du monde. Leur monde a été totalement détruit. « Nous sommes des sociétés post-apocalyptiques ». Comment vit-on après ça ?
L’écrivain, également journaliste, amène beaucoup de lumière dans son tableau. Et une très belle humanité. Peut-être parce qu’il y’a mis un peu de lui (notamment dans le personnage de Lizbeth). Aussi parce qu’il a passé des heures à observer ces gens dont sont inspirés ses personnages. Et qu’il leur porte une réelle affection et un profond respect.
La langue qu’il emploie pour raconter leur histoire est la leur. Simple. Sans fioriture. Pratique. Un peu déconcertant au départ, on se laisse finalement embarquer.


- Michel Jean, Tiohtiá:ke, Seuil, Voix autochtones, 2023, 224 p.