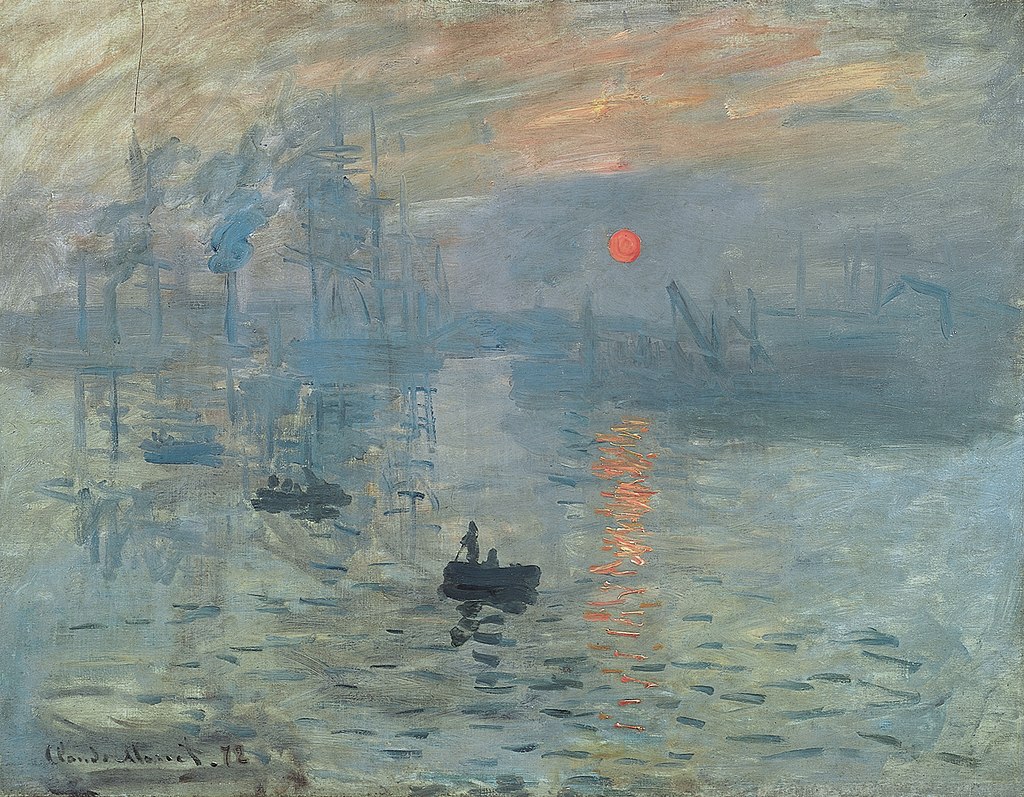Assis à la terrasse, le vieil homme ne quitte pas des yeux l’immeuble cossu de l’autre côté de la rue. Il desserre son écharpe, laissant apparaître un nœud papillon aux couleurs vives. Ses mains tremblent légèrement quand il porte la grande tasse de café fumant à sa bouche. La légère buée qui se dépose sur ses lunettes rondes en écaille ne l’empêche pas d’apercevoir une silhouette derrière une fenêtre du deuxième étage.
Dans son appartement, Jacqueline chantonne une comptine enfantine, emmitouflée dans un kimono en brocart cobalt. Elle jette un regard par la fenêtre. Le vent a chassé les derniers nuages. Quelques flaques miroitent encore dans les caniveaux. Seul un homme au crâne rond et dégarni a bravé les derniers frimas pour profiter de la terrasse. Certainement un fumeur. Les odeurs de jus d’orange frais et de lapsang souchong la ramènent dans sa cuisine.
Chaque petit-déjeuner suit le même cérémonial depuis son adolescence. L’orange pressée par sa mère. Le thé noir fumé de son père en lisant le journal. Des rituels auxquels se rattacher après leur rencontre tragique avec un platane sur une route de campagne. Jacqueline pose son regard sur ses mains. La peau fine, diaphane, froissée, les petites taches brunes, le réseau de veines violettes, les doigts noueux la ramènent à la réalité de son âge. Une ombre de tristesse traverse ses yeux bleus. Comment a-t-elle pu oublier une vie entière ?

En ouvrant les yeux à l’hôpital, elle avait vingt ans, un avenir, des rêves, des envies. Puis elle avait vu ses mains et elle n’avait plus rien compris. On lui avait parlé de son mari, de ses petits-enfants. Un silence gêné quand elle avait demandé qui était leur père. Son fils n’avait pas pu venir. Mais il ne lui manquait pas. Aucun d’entre eux d’ailleurs.
Leurs visages ne réveillaient aucune émotion, aucune intimité, aucun souvenir. Chacun apportait son passé, son chagrin et l’espoir de réveiller en elle une complicité perdue. Elle n’avait plus supporté leurs mines affligées, leurs gestes trop proches, leur besoin viscéral de la toucher, serrer sa main, caresser sa joue, l’embrasser. Autant d’agressions pour elle.
Surtout, elle ne les reconnaissait jamais. Chaque visite était une première rencontre. Ils devaient lui rappeler qui ils étaient. Un calvaire qui déchiraient leurs cœurs autant que le sien. Eux, de l’avoir perdue. Elle, rongée par la culpabilité de faire souffrir ces inconnus plein de sollicitude. Non seulement elle avait oublié cinquante ans de sa vie mais elle était souvent incapable de se souvenir des quinze dernières minutes.
Jacqueline se ressert de thé. Elle n’a aucun souvenir de sa maternité mais sait parfaitement quelles feuilles infuser pour recréer l’ambiance de sa jeunesse, la présence rassurante de ses parents. Elle prend sa tasse et se tient debout, près de la fenêtre. L’homme est toujours là. Il ne fume pas. Il lève la tête et leurs regards se croisent. Elle ne peut s’empêcher de lui sourire. Il la salue d’une main délicate. Une main âgée comme la sienne. Il lui sourit tranquillement et l’invite à descendre le rejoindre. Elle pouffe en mettant sa main devant la bouche. Son assurance l’amuse. Ils entament une conversation silencieuse. Mais qu’il ne s’y trompe pas, elle n’est pas une fille facile.
Le ciel s’est couvert et une pluie fine floute leur conversation. L’homme quitte la table, il tient un parapluie à la main et se met à danser tel Gene Kelly dans Singing in the rain. Il s’arrête en tournant le visage vers elle, les bras écartés. Des gouttes d’eau dégoulinent sur son visage rayonnant de malice.
Il ne voit plus rien derrière ses lunettes couvertes de gouttelettes mais il sait qu’elle viendra. Si ce n’est pas aujourd’hui, ce sera demain, après-demain, ou le jour suivant. Elle a déjà accepté de le rejoindre. Il lui avait offert un thé vert au citron. Ce bistrot ne propose pas de lapsang souchong. Lui, il prend toujours un grand café américain. Elle aime l’odeur du café mais pas le goût. Dans leur jeunesse, elle avait l’habitude de poser sa tête sur son épaule pour humer son café.
Il retourne s’assoir à sa table, essuie ses lunettes et resserre son manteau sur son nœud papillon. A son âge, il ne faudrait pas qu’il attrape froid. Derrière la fenêtre et son rideau de pluie, la silhouette de Jacqueline semble applaudir. Elle a toujours beaucoup aimé ce film, subjuguée par le sourire charmeur de Gene Kelly. La danse était leur passion commune. Trois pas de cha-cha-cha pour enterrer une dispute. Un tango pour les grandes occasions. Un rock quand ça leur chante. Un fox-trot pour se faire plaisir. Elle ne peut pas avoir tout oublié.
Jacqueline a enfilé un simple jean, une chemise blanche et un pull en cachemire rose pastel. Elle attrape son grand manteau jaune moutarde dans l’entrée, se regarde une dernière fois dans le miroir. Elle replace une mèche de cheveux argentés dans son chignon. La femme qu’elle voit dans le miroir n’est pas beaucoup plus jeune que l’homme de la terrasse. Elle a encore du mal à admettre qu’il s’agit d’elle.
Elle délaisse l’ascenseur asthmatique pour le tapis moelleux des escaliers. Elle a toujours été sportive. Elle descend d’un pas léger, avec l’excitation d’une adolescente à son premier rendez-vous. Cet homme lui semble sympathique. Elle se réjouit de cette rencontre qui mettra du soleil dans cette journée de printemps morose. La pluie s’intensifie alors qu’elle s’avance sur le trottoir. Elle n’a pas pris de parapluie et court pour s’abriter rapidement sous l’auvent du bistrot.
L’homme est venu l’accueillir. Il tire une chaise à sa table et l’invite à s’assoir. Il a quelque chose de tendre dans le regard. Jacqueline frissonne quand sa main effleure la sienne.
« – Quelle situation désarmante ! s’exclame-t-elle. Je n’ai pas l’habitude de rejoindre des inconnus en bas de chez moi.
– Je m’appelle Serge. Si vous me donnez votre prénom, nous ne serons plus des inconnus et je pourrais vous offrir un thé. Ou un café, se rattrape-t-il aussitôt. »
Elle ne doit pas savoir qu’il connaît tous ses goûts. Il sait comment l’enthousiasmer ou l’agacer. L’odeur de lavande la rend joyeuse. Il suspend un sachet au cintre de son manteau pour qu’une effluve délicate s’en dégage. Elle ne supporte pas les pleurnicheries. Il n’est pas là pour pleurer. Il n’est pas très certain d’avoir encore des larmes.
Il en a vidé une grosse partie avec elle, à la mort de leur fils. Un accident de voiture. Comme un écho douloureux à la mort de ses parents. Le choc avait été tellement violent qu’elle avait effacé l’évènement. Quand elle demandait des nouvelles de Lucas, il devait expliquer, encore et encore, l’insupportable absence. Puis était venu l’AVC. Ils avaient tous disparu de sa mémoire. Lui, Lucas, Marianne et les petits. A l’hôpital, ils avaient dû affronter son regard au mieux neutre, parfois craintif, souvent en colère lors de leurs visites.
Quand elle avait demandé à ne plus les voir, Serge avait compris qu’elle ne reviendrai jamais vivre chez eux. Il lui avait alors trouvé ce petit appartement confortable à deux pas de leur maison. Rien ne lui paraissait étrange, puisque tout était nouveau pour elle. Il avait déménagé ses meubles favoris, ses objets fétiches et sa garde-robe. Il avait gardé les cadres et les albums photo, les traits de crayon marquant la croissance de Lucas sur le mur de sa chambre et les jouets de ses petits-enfants qu’il garde le mercredi. Marianne les dépose avant de partir travailler.
Les autres jours, sans exception, il prend son petit-déjeuner au Balto en face de l’appartement de Jacqueline. Il met un costume et des souliers vernis. Elle a toujours été attirée par les hommes bien habillés, voire en uniforme. Il avait hésité à en acheter un d’occasion, n’importe lequel. Mais sur un homme de son âge, ça aurait manqué de charme. Il s’assoit en terrasse dans l’espoir qu’elle le voit. Chaque fois qu’il réussit à attraper son regard, il tente de la faire venir.
Il a attendu des semaines. Il a eu le temps de sympathiser avec le serveur. Il trouve ce vieux bonhomme tendrement fou. Serge le comprend. Fou, il l’est. D’amour pour sa femme. Après tout, quel meilleur moyen d’entretenir la flamme de leur jeunesse que cette éternelle séduction ? Peut-être, un jour, pourra-t-il l’emmener danser ?