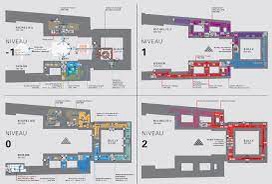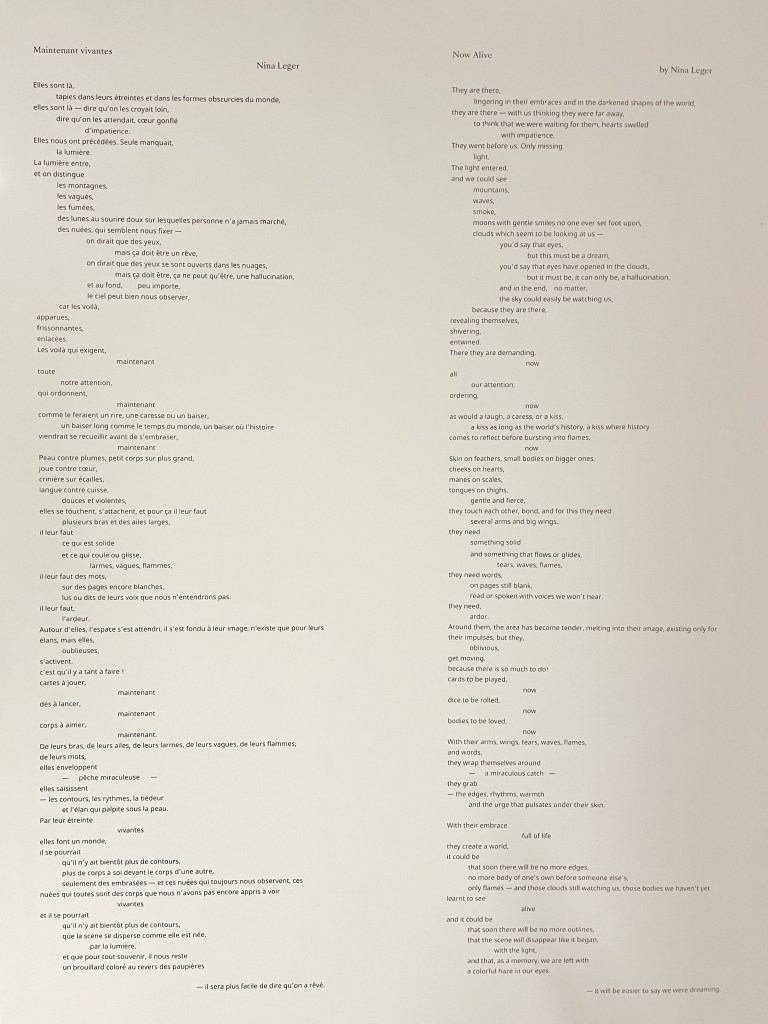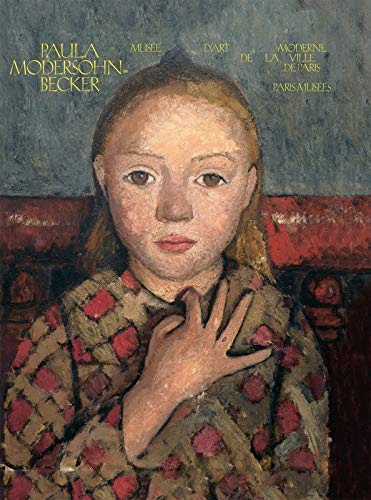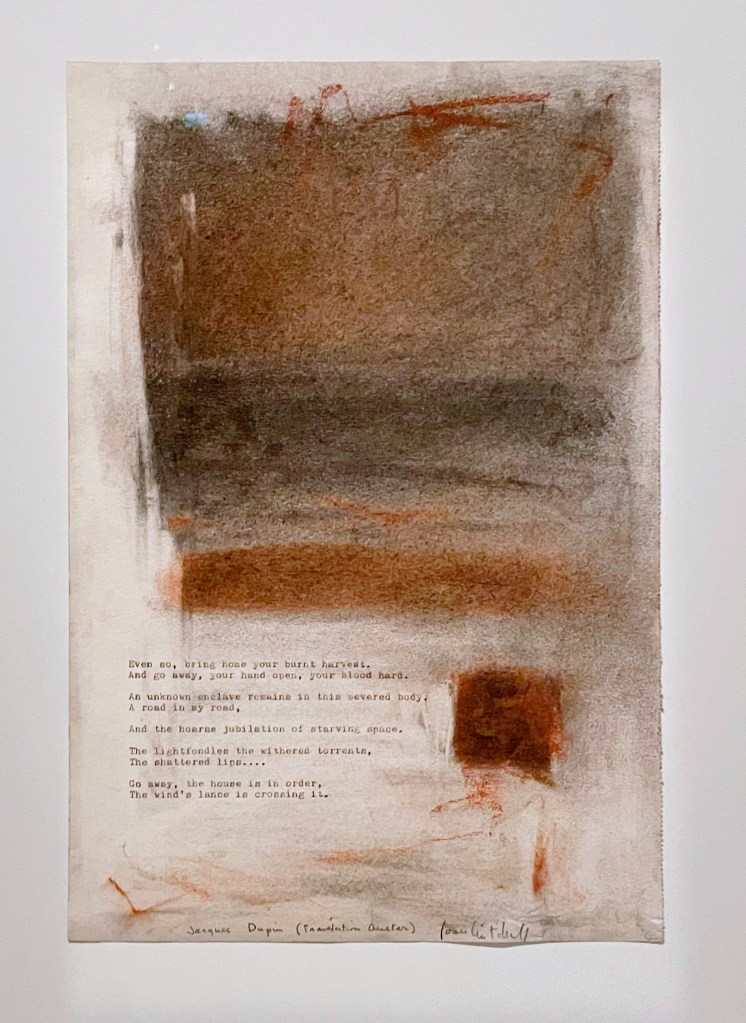« Rapprocher Manet et Degas, c’est chercher à comprendre l’un à partir de l’autre ». Tels sont les premiers mots de la brochure guidant la visiteuse dans l’exposition Manet / Degas au musée d’Orsay.
Pourtant, je n’ai pas trouvé que le rapprochement fasse des étincelles. Eglantine a aussi estimé que le plus intéressant dans cette exposition étaient les textes qui racontaient, documentaient et expliquaient la relation entre ces deux monstres sacrés de la peinture française du XIXe siècle.
Nés à deux ans d’intervalle, tous les deux issus de la haute bourgeoisie, d’abord destinés à des carrières de juristes, Manet et Degas ont énormément de points communs. Mais là où Manet rayonne dans la société de l’époque, charismatique, séducteur, professoral, exposant au Salon, Degas apparaît discret, concentré, besogneux, célibataire endurci, presque solitaire. Il peint un portrait de Manet avec son épouse ? Celui-ci, insatisfait de la représentation de sa femme, coupe la toile pour la faire disparaître. Si Degas prend régulièrement Manet pour modèle, la réciproque ne viendra jamais. Un peu comme ces amis que vous invitez à dîner et qui ne rendent jamais l’invitation. Le déséquilibre est flagrant.
En ressortant de cette exposition, j’ai eu besoin de revoir les danseuses de Degas, pour retrouver les couleurs et l’audace de ce peintre que je n’ai pas trouvé valorisé dans l’exposition. Peut-être, justement, à l’image de leur relation dissymétrique. Degas admirait sincèrement Manet. Au point de collectionner ses toiles et ses dessins. Et que dire de l’énergie mise à réunir les différents fragments d’une toile de Manet, L’exécution de Maximilien. Cette toile monumentale était trop subversive à l’époque pour être exposée et avait été découpée en morceaux après la mort de Manet.

Alors que Manet a tranché la toile offerte par Degas, ce dernier a, lui, mis tout en œuvre pour reconstituer celle de son ami. L’œuvre actuelle, une grande toile vierge sur laquelle sont collées les différentes parties retrouvées par Degas, dégage une émotion particulière. Ce grand format recomposé reflète l’amitié chaotique, fragmentée, déchirée, de ces deux talents.
Pas de méprise toutefois sur l’extraordinaire chance de voir toutes ces œuvres de Manet et Degas réunies dans cette belle exposition. Mais le déséquilibre de leur relation transparaît trop fortement pour que je m’émerveille pleinement de la rencontre de leurs œuvres.
Des styles de portraits très différents
Dans les portraits, Manet peint son ami Zola, avec en arrière-plan une gravure de son Olympia, mise en abîme de son propre succès et de ses relations. De Degas, j’ai été particulièrement émue par le portrait de L’amateur d’estampes. Un anonyme, un peu vouté, dans un environnement dédié à sa passion. A l’image d’un Degas se tenant loin des mondanités, concentré sur son art.


Manet éblouissant, Degas émouvant
Au long de l’exposition, mon regard fût systématiquement d’avantage attiré par les peintures de Manet. Plus flamboyantes, plus contrastées, elles avaient sur moi un effet magnétique, époustouflant. Pourtant, avec un peu de recul, quand je regarde les œuvres que j’ai photographiées, je me sens plus touchées par celles de Degas.
Si je prends l’exemple des modistes, la femme du tableau Chez la modiste de Manet est éblouissante, belle, vive. Elle attire le regard, attise le désir, réveille les sens. Alors que celle de Chez la modiste de Degas, est douce, tendre, presque perdue au milieu des chapeaux. Elle dégage une émotion presque vulnérable. Moins tape-à-l’œil que Manet, mais tellement plus sensible.


Degas, l’art de saisir l’instant
Pour finir, si je devais comparer leurs peintures avec de la photographie contemporaine, je verrais Manet avec un gros appareil photo professionnel, visible, assumé alors que Degas utiliserait plutôt un téléphone portable pour saisir des images sur le vif. Derrière le cadrage de L’absinthe, on peut imaginer – en total anachronisme évidemment ! – un homme sortant son portable pour saisir la femme tristement alcoolisée à la table voisine. Alors que, avec le même modèle, Manet se positionne frontalement, utilise des couleurs vives et montre une femme non pas triste, mais alanguie, ouverte à la séduction.


On retrouve cette façon de saisir ses contemporain.es avec la Blanchisseuse et Femmes devant un café, le soir. Comme si Degas ne cherchait pas le beau mais le vrai de l’instant et de l’émotion.


Moins impressionnant au premier regard, plus persistant dans la durée du sentiment. Malheureusement, la force de Manet écrase trop la délicatesse de Degas dans cette exposition. Peut-être aurais-je préféré une exposition Degas / Manet. Car les deux stars de l’exposition restent l’Olympia et Le Balcon d’Édouard Manet, concentrant les regards et l’intérêt des visiteurs.euses.