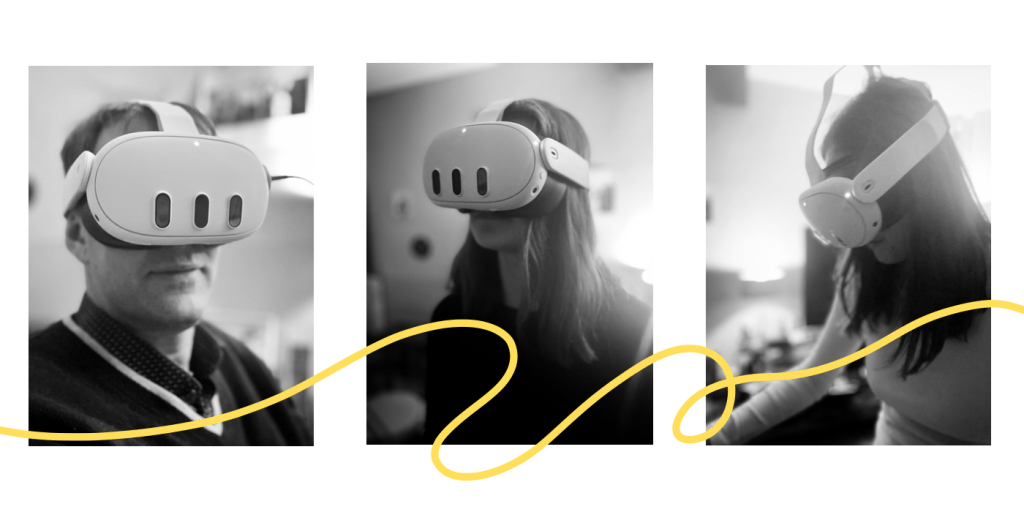Dans les lumières du tramway qui nous conduit au théâtre ce soir, je n’ai pas vraiment idée de ce que nous allons voir. Avare de mots, gardant ses sensations, Hortense m’a peu parlé du décor dont elle a suivi la mise en place, ou des répétitions auxquelles elle a assisté. Elle est la stagiaire de troisième, un peu timide, impressionnée, faussement détendue, follement heureuse de sa découverte de l’entreprise à travers le monde particulier des régisseurs et des machinistes. Toutes ces mains invisibles qui préparent, ajustent et coordonnent la réussite d’un spectacle. Je sais simplement que Cosmos parle des femmes et de l’espace.
Sur scène, cinq femmes, cinq voix, cinq corps qui incarnent l’histoire des femmes dans la conquête spatiale. États-Unis, fin des années 50, le programme Mercury 13 prépare treize femmes, toutes pilotes expérimentées, à rejoindre les étoiles. Un rêve grand comme l’univers qu’elles touchent du doigt. Leurs performances égalent ou dépassent celles des militaires, des hommes, sélectionnés avant elles. La chute est vertigineuse, laissant un vide béant, une frustration pleine de rage, quand le programme est annulé la veille de la troisième phase, celle qui devait les voir entrer sur une base militaire et commencer l’entraînement aux commandes d’avions de chasse.
Danse, chant, acrobatie, comédie… La scène s’embrase, le décor devient lunaire, on sent l’apesanteur, se retrouve devant le congrès américain ou dans des cocktails mondains, dans des tests physiques intenses ou sur un plateau des télévision. Les basses vibrent sous nos pieds tandis que décollent les fusées des hommes. On suit le combat de ces treize femmes pour conquérir leur place dans cette course folle vers l’espace. Finalement, la première astronaute sera russe. Pourtant, les treize Américaines étaient toutes prêtes et motivées bien plus tôt. Clouées au sol par un ordre social décrété immuable par les hommes, elles n’ont jamais cessé de rêver.
La dernière d’entre elle avait quatre-vingt-deux ans quand, finalement, elle a été invitée à partir en orbite. Si elle n’a pas été la première, elle a été la plus âgée. Elle avait vingt au moment du programme Mercury 13. Sentiment d’un immense gâchis.
Pourtant, cette pièce affiche un immense espoir, porté par un univers poétique de poussières d’étoiles, les pulsations d’une bande-son enthousiasmante, une mise-en-scène ardent et le talent joyeux et puissant des comédiennes.
Le décor est surprenant. Deux grand murs blancs formant un angle traversé d’une poutrelle métallique. il paraît très simple. Il s’avère complexe. Des ouvertures se créent au fur et à mesure du spectacle. On défonce les murs, ouvre des portes, dégage des fenêtres, gravit des échelons. Les actrices montent et descendent, la tête en bas, debout ou couchées. Elles bousculent ainsi les idées reçues et nous embarquent dans cette folle aventure de l’espace, d’hier à aujourd’hui, le regard tourné vers demain.
Oscar Wilde disait : « Il faut toujours viser la lune, car même en cas d’échec, on atterrit dans les étoiles ». Dans le tramway du retour, nous avions encore des étoiles plein les yeux.
Cosmos, de Maëlle Poésy, à l’Azimut.