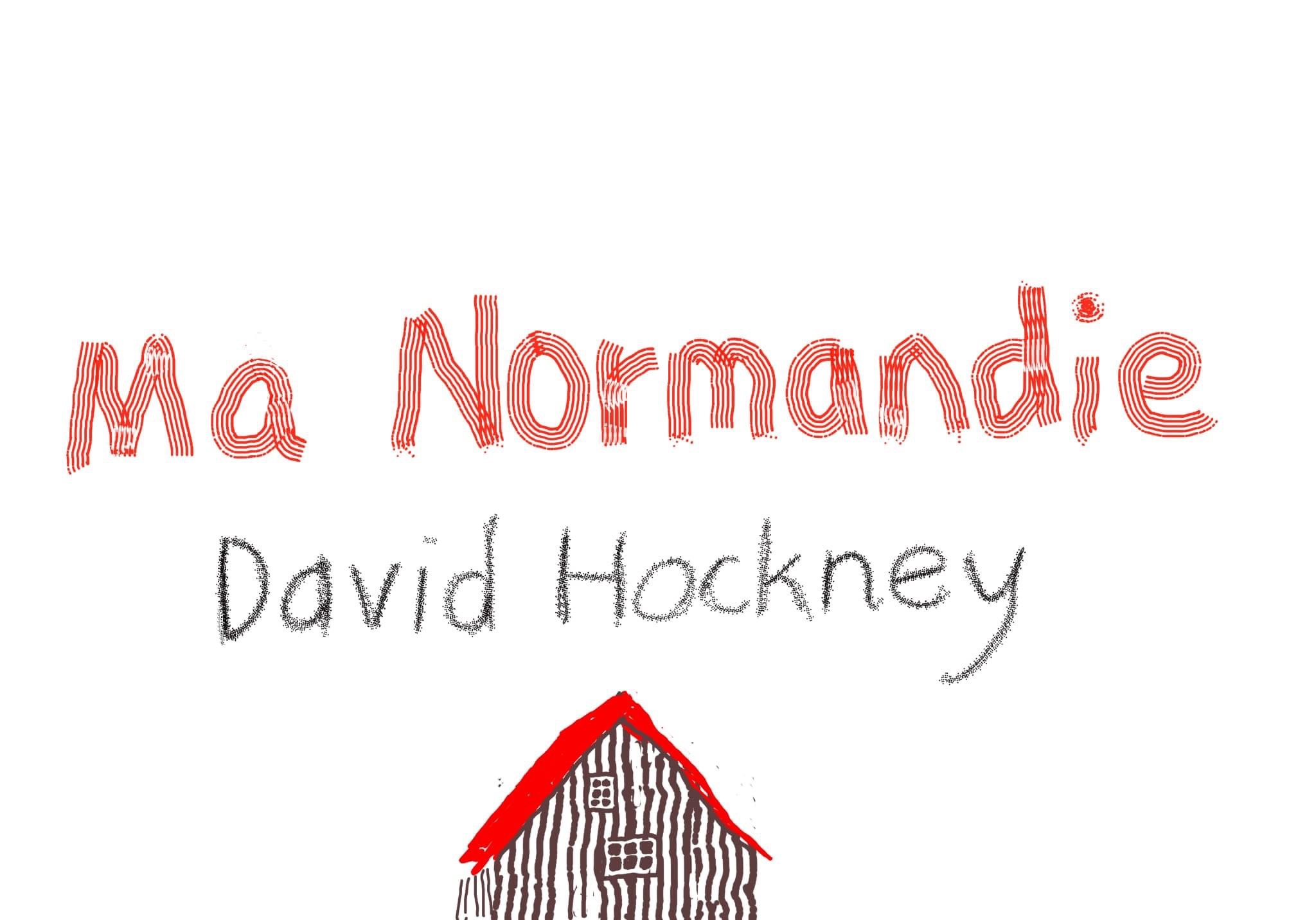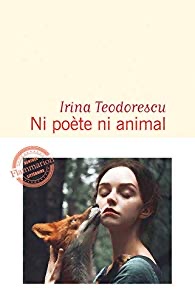Un petit livre sur les étagères d’une librairie. Un auteur connu que, pourtant, je ne découvre réellement que maintenant. Georges Perec. Sans accent sur le e, parce que son nom n’est pas breton mais polonais. Le e, cette lettre si présente dans son patronyme qu’il a pourtant décidé d’éluder pour écrire tout une histoire, La disparition. C’est par ce texte, surtout, que je le connaissais mais dont, avouons-le, je n’ai toujours lu que des extraits. Il est comme ça des auteurs qu’il nous semble avoir toujours côtoyés mais que nous n’avons pourtant pas lus.
Certains parce l’œuvre semble trop inaccessible ou tellement volumineuse qu’elle pèse avant même de l’avoir commencée, tel Marcel Proust. D’autres, comme Perec, parce qu’ils sont là, tellement présents, incontournables, fondus dans le quotidien, tellement accessibles, qu’il nous semble déjà les connaître parfaitement.
Il a fallu un livre sur l’écriture de nouvelles pour que je m’installe Place Saint Sulpice sous la plume de Perec. Tentative d’épuisement d’un lieu parisien est un tout petit livre dans lequel il ne se passe rien. Perec y décrit les gens, les bus et autres véhicules qui passent sous ses yeux. Il les compte, les décrit, les attrape tels des papillons dans ses filets d’écrivain. Par petites touches, savant impressionniste, il fait fourmiller la vie sur le papier. La place s’anime à travers les pages. Le quotidien devient l’histoire.
J’étais époustouflée par la prouesse. Et confortée dans la certitude que ce sont les détails d’un lieu ou d’un personnage qui lui apportent de la profondeur. Que la trace laissée par le thé sous la tasse lui donne plus de réalité.
Au détour d’une librairie, je tombe sur une autre livre de Perec, Les choses. Je me laisse emporter dans les rêveries d’un grand appartement parisien, cossu et décoré avec goût. Les descriptions sont méticuleuses. J’utilise parfois le dictionnaire. Le vocabulaire est précis, juste, savamment distillé. Comme j’ai d’abord lu Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, je fais tout de suite le rapprochement cette accumulation de détails qui génère toute la puissance Des choses. Ce livre a pourtant était publié en 1965 alors que Tentative l’a été vingt ans plus tard.
Ces premières pages ne sont que l’image des désirs de Jérôme et Sylvie. Tout au long du livre, les deux personnages – qui n’ont rien d’héroïque – sont avant tout racontés à travers les objets qui les entourent, ceux dont ils rêvent, ceux dont ils ont encombré leur petit appartement parisien, ceux qu’ils emportent en Tunisie ou plus tard à Bordeaux. Comme une tentative d’épuisement des choses elles-mêmes.
J’espère réussir à écrire un jour quelque chose d’aussi fort avec si peu d’artifices.
Je vais continuer à découvrir Georges Perec. Il me reste ses deux livres les plus connus, La vie mode d’emploi et La disparition.