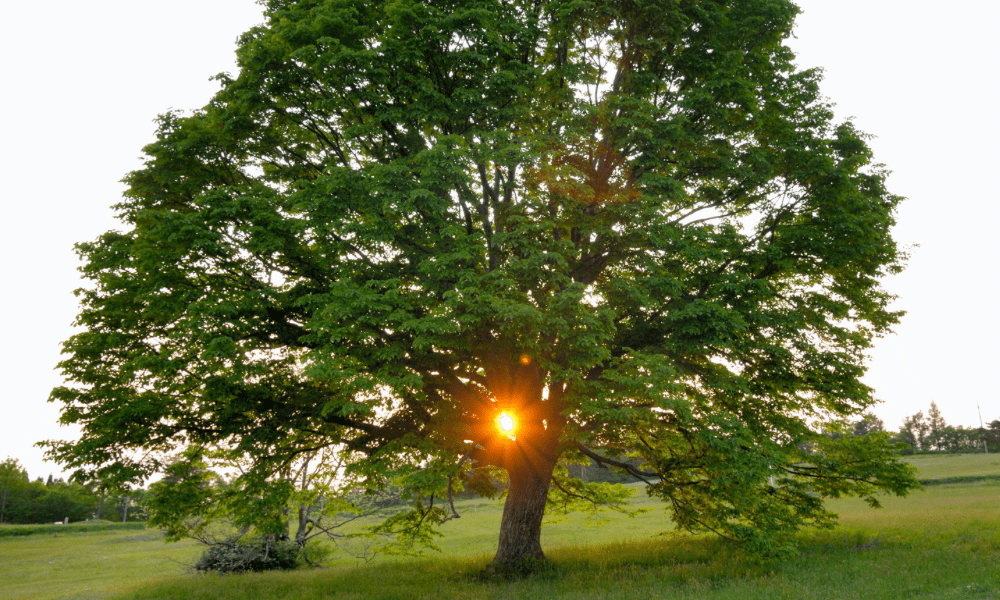La vallée s’éveille dans les brumes bleutées de la nuit. Sophie jette un dernier coup d’œil par la fenêtre. Les rares lampadaires réchauffent les murs de pierre grise et les toits de tôle. L’acier a remplacé depuis longtemps les bardeaux de mélèze sur les maisons. Rien n’est immuable. Même pas la montagne. Le glacier de ses souvenirs d’enfance s’est ratatiné comme ses rêves de jeune femme.
Elle avait vingt-trois ans lorsqu’elle avait rencontré Karim. Elle terminait son école de commerce. Il travaillait déjà au service informatique du rectorat de Versailles. L’avenir leur ouvrait des bras enthousiastes. Le premier appartement. Les voyages hors saison. Puis les enfants. Trois. La maison pleine de vie. Les rires, les pleurs. Les parties de Uno et de Monopoly. Les barbecues entre amis. Les vacances en Corse ou en Bretagne. Karim avait besoin de la mer pour se ressourcer. Elle avait oublié qu’elle préférait la montagne.
Malgré sa grosse polaire et son coupe-vent, Sophie frissonne en rejoignant sa voiture. La fraîcheur de la nuit alpine surprend alors que la canicule estivale accable le reste du pays. Le ciel est plissé de nuages aux contrastes gris perle et ardoise, derrière lesquels perce déjà une lumière jaune pâle. La route serpente au creux des montagnes. Au loin, Sophie distingue Briançon, moulée dans ses contreforts, un voile blanc accroché à ses toits. Elle se gare sur le parking près du rond-point d’où part la route vers le col du Granon. Alex et Chloé arrivent juste après elle. Ils ne tardent pas à apercevoir le van de Nico, floqué du logo de l’école Univ’air Briançon Parapente.
En habitué de la montagne, Nico enfile les virages à vive allure. Les discussions joyeuses atténuent la nausée de Sophie. A presque cinquante ans, elle n’est pas la plus âgée du groupe mais la majorité des élèves a plutôt la trentaine. Seul Pascal a quelques années de plus qu’elle. A l’avant, Chloé pose sa tête sur l’épaule d’Alex. Comme elle posait la sienne sur celle de Karim lorsqu’elle était fatiguée. Cette épaule lui manque terriblement depuis deux ans qu’il l’a quittée.
Il n’est même pas parti pour une autre, une plus jeune, une plus mince, une plus vive. Il est parti parce qu’il ne l’aimait plus. Parce qu’il était malade à l’idée de rentrer chez lui après sa journée de travail. Parce que leur thérapie de couple ne débloquait rien. Parce que vivre sans elle était devenu sa seule façon de se retrouver, lui. Il avait toujours beaucoup d’affection pour elle. Plus suffisamment pour vivre ensemble. Il était parti à la fin du mois de février, ce mois rabougri comme un sursis, deux ans auparavant.
Un peu avant le col, Nico s’engage sur un chemin caillouteux à flanc de montagne. Les chaos finissent de retourner l’estomac de Sophie. Alors elle se concentre sur les flamboiements vifs qui apparaissent derrière le ciel de plomb, annonçant le lever du soleil. La camionnette s’arrête enfin dans un renfoncement du chemin. Sophie charge sa sellette et sa voile sur son dos. Le groupe monte en file indienne la pente raide qui mène à la zone de décollage. Les silhouettes sombres, courbées sous le poids des gros sacs, se détachent dans les premiers rayons du soleil qui paraît de l’autre côté de la crête.
Sophie étend sa voile sur l’herbe courte. Pascal, qui en est à son troisième stage, vient l’aider à bien séparer ses lignes de suspentes. Elle, c’est son premier vol. Depuis trois jours, elle s’entraîne sur la pente école au col du Lautaret et ingurgite des tonnes d’informations techniques et théoriques dans le local d’Univ’Air à Briançon. Elle se concentre pour ne rien oublier. Aucun tour n’emmêle sa sellette, ni ses poignées de commande. Le parachute de secours est en place. Elle contrôle dix fois que sa sellette est correctement attachée, teste la radio et refait le double-nœud de ses chaussures.
Sur sa droite, la pointe du Petit Aréa s’illumine dans le soleil naissant. A gauche, dans le lointain, elle distingue le Queyras. En face, les derniers nuages s’accrochent aux sommets enneigés des Ecrins. Le groupe attend dans le silence de la montagne. Quand le vent tourne enfin, chacun se met en position et attend les ordres de Nico. La voix de Tom, l’autre moniteur, crachote dans la radio. Il est redescendu avec le van et les guidera depuis le terrain d’atterrissage. Sophie n’entend pas le cri de la marmotte qui résonne dans l’air frais. Elle est concentrée. Elle en oublierait presque de respirer. Pascal tente de la détendre avec une blague quand on appelle son nom.
Alors Sophie exécute les gestes qu’elle a répété des dizaines de fois sur la pente école. Les mains à hauteur des épaules, elle se penche en avant et commence à courir dans la pente. Elle sent la voile qui se lève derrière elle et prend de la vitesse. « Tempo, tempo » crie Nico dans la radio. Elle freine la voile pour qu’elle ne passe pas devant elle et continue de courir dans la pente. En un instant, le sol se dérobe sous ses pieds. « Bravo Sophie ! » la félicite Nico dans la radio. « Maintenant, sans t’appuyer sur tes commandes, tu vas t’assoir. Ne bouge pas tes mains. Là. Et tu me fais le signal quand tu es assise. » Sophie s’installe dans sa sellette et hurle « hihaaaaaaaa ». Un bon moyen pour décharger cette première montée d’adrénaline.
Le vent froid siffle dans son casque. Elle n’en revient pas. Elle a réussi. Elle vole ! Elle reprend sons souffle et pense à Karim. Ce premier vol en parapente, seule dans sa sellette, marque le début de sa nouvelle vie sans lui. Portée par le vent mais tenant les commandes. Elle descend doucement vers le champ où l’attend Tom. Concentrée sur les points de repère mémorisés avant le décollage, écoutant les instructions de Tom, se remémorant les consignes d’atterrissage, elle profite à peine de la sensation de légèreté que procure le parapente, cette impression d’être assise dans une gigantesque balançoire dans les nuées.
Demi-tour par la droite. Quart de tour par la gauche. Guidée par la voix de Tom qui grésille dans la radio, elle sort de sa sellette pour se mettre debout, bras hauts, prête à atterrir. Elle s’approche du sol à vitesse maximale, corrige légèrement à droite pour éviter un arbre puis descend ses mains sous les fesses pour freiner complètement. La voile s’affaisse doucement dans son dos. Elle court un peu afin que toute la voile se pose derrière elle. Elle a quelques minutes pour ramener sa voile en tirant sur les suspentes, la mettre sur son dos et quitter l’atterro pour laisser la place au suivant.
Elle rejoint le reste du groupe sous les arbres au bord du champ. Un ruisseau court de l’autre côté des buissons. Une odeur de reine des prés embaume la matinée estivale. Sophie se détend petit à petit, recevant les félicitations des membres du groupe qui ont atterri avant elle. Le vol n’a duré que sept minutes mais Sophie est exténuée. L’âge, le surpoids, le manque de pratique sportive, pense-t-elle. Ce vol solo en parapente était un incroyable défi pour elle.
Quand son petit dernier avait quitté la maison en septembre, poursuivant ses études à Lyon, elle s’était retrouvée vraiment seule. Elle qui, pendant des années, avait rêvé de silence alors que les enfants criaient, riaient et chahutaient, ne supportait plus le mutisme de la maison. Elle avait pleuré à grosses larmes sur les albums de famille, remontant jusqu’à ses propres photos d’enfance. Les vacances avec ses parents à la montagne, les grandes randonnées avec les copains, les folles parties de volley le soir au bord de la Guisane, les premières cuites à l’Alpen. Elle n’avait pas transmis ces souvenirs à ses propres enfants.
Etiolée par l’hiver parisien, rongée par la solitude, laminée par le boulot, elle avait surfé sur internet à la recherche d’une location pour l’été dans cette montagne qui lui avait tant apporté. Elle était tombée sur le site d’Univer’Air Briançon Parapente. « Pourquoi pas » s’était-elle encouragée en réservant un stage pour débutants.
« Superbe, ton atterrissage, Sophie ! » lance Pascal en rejoignant le groupe, sa voile bouchonnée sur le dos, les lignes colorées des suspentes dans la main droite. « Moi, la première fois, j’ai atterri dans les buissons. » Le bleu de ses yeux pétille. Sophie rit avec lui. Le groupe termine de ranger les voiles dans les sacs des sellettes. Ce sera le seul vol de la journée car, en réalité, tout le monde est crevé. Ils retournent à l’école pour des cours théoriques.
Quelques nuages moutonnent toujours l’azur mais la chaleur estivale écrase déjà la végétation. En reprenant sa voiture pour rejoindre l’école, Sophie se sent différente. Des voiles colorées tournent encore dans le ciel. Elles semblent minuscules. Pourtant, quelques heures auparavant, dans le soleil levant, manœuvrant elle-même sa voile immense, Sophie a retrouvé la force des rêves.